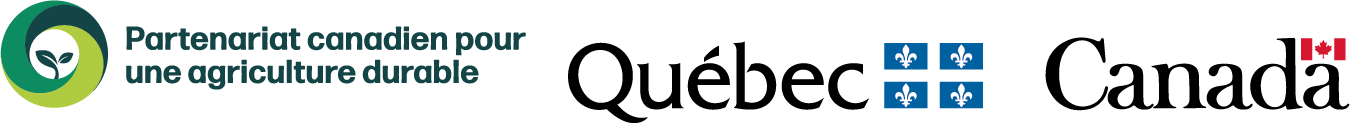Ouverture imminente des services de mentorat GIEC en grandes cultures et horticulture maraîchère et fruitière.
Restez à l’affût! La date d’ouverture de la plateforme et des inscriptions pour ces services de mentorat sera annoncée dans le bulletin d’information La CSC vous informe!
Abonnement à l'infolettre : https://coordination-sc.org/infolettre-unique/